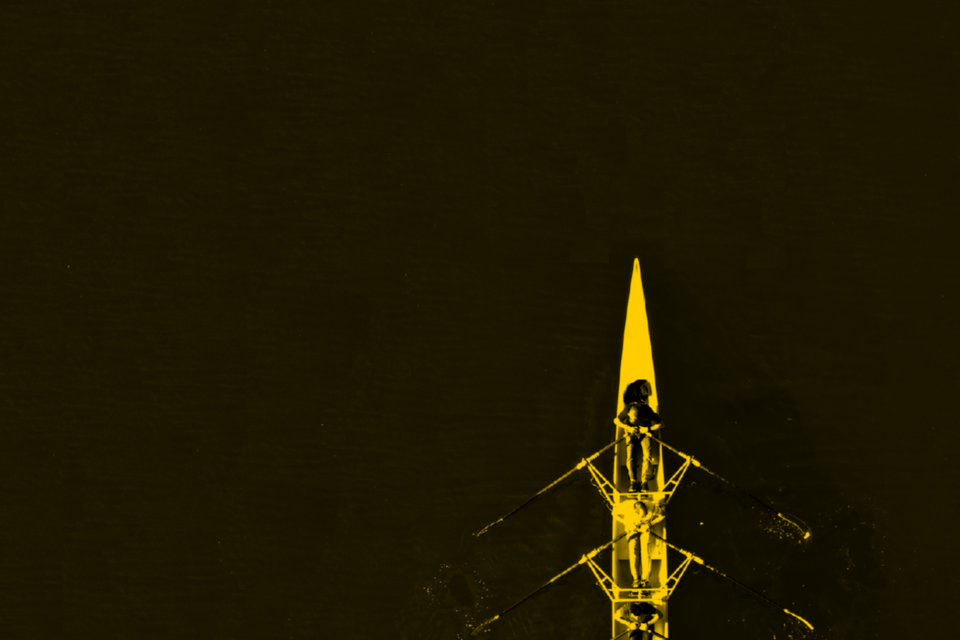Dans le cadre de la publication de l'ouvrage collectif "Les Groupes d'intérêt en France", dirigé par Guillaume Courty et Marc Milet, nous avons eu le plaisir d'échanger avec le premier des deux auteurs dans un long entretien que nous vous restituons en trois parties : 1/ La genèse de l'ouvrage ; 2/ Les représentants d'intérêt vus par la recherche académique ; 3/ La démocratie participative et ses enjeux.
Il s’agit du premier ouvrage depuis 60 ans sur les représentants d’intérêts. Pourquoi selon vous cette profession a-t-elle été délaissée par les chercheurs ? Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de vous pencher sur le sujet ?
Il y a bien eu des ouvrages portant sur les représentants d’intérêts ces soixante dernières années en revanche, il n’y a pas eu de travaux visant à proposer un panorama de la situation et de son évolution en France.
Un objet inexistant ?
Quand j’ai commencé mes travaux, l’une des questions de la part d’un recruteur pour le CNRS a été de savoir pourquoi j’étais le seul à proposer cet axe de recherche, pourquoi tout le monde s’en était désintéressé. Les personnes qui nous recrutaient avaient connu les années 60 pendant lesquels de nombreux travaux fleurissaient. Il y en avait en éco, en droit, en science politique. Puis, d’un seul coup, comme un feu qui s’éteint, dans les années 70-80, plus personne ne travaillait là-dessus.
Cela a fait partie de l’énigme de départ : « est-ce que c’est parce que l’objet n’existe plus ? ».
Cela n’était pas totalement faux dans la mesure où, dans les années 70, il y a eu tout un engouement, au moment de l’élection de Giscard d’Estaing, autour du mouvement associatif. Il y a eu un recentrement de la focale du pouvoir politique sur tout ce qui était l’émergence de l’associatif, la croyance dans l’importance du mouvement associatif vis-à-vis des organisations professionnelles qui étaient présentées comme un vieux monde un peu décati et trop arc-bouté sur la défense du corporatisme. Néanmoins cette dynamique du monde associatif à une période n’explique pas tout.
Il y a d’autres phénomènes qui sont intervenus depuis.
Premier phénomène : une discipline récente
Ma discipline est relativement jeune en France. Elle a été vraiment instituée par des concours de recrutement à partir des années 70 puis massivement dans les années 90. Lorsque je démarre, on se connaît tous et les objets canoniques de la science politique ne comportent plus les groupes d’intérêt. On travaille de plus en plus sur les politiques publiques et les mobilisations, moins sur les partis et les élections.
Le Parlement était un grand vide tout comme l’étaient les groupes d’intérêt. Un vrai trou noir, tout comme un tas de facettes de la vie politique, parce que notre discipline était vraiment balbutiante donc il n’y avait pas eu de travaux universitaires semblables.
Deuxième phénomène : la prise en compte d’une définition large de l’influence
Notre discipline, comme beaucoup de sciences sociales, était souvent assez militante. S’intéresser à tout ce qui tourne autour des milieux économiques n’attirait pas de grande sympathie. Il y avait déjà assez peu de travaux portant sur le syndicalisme, alors proposer des travaux sur le syndicalisme patronal …
Cette fibre militante n’a pas disparu, mais la vision du périmètre couvert par les groupes d’intérêt est bien plus globale. Y sont assimilés à juste titre les ONG, les entreprises et les syndicats. En somme, on a fait le deuil des objets qui n’étaient pas considérés comme canoniques ou particulièrement centraux, on peut donc s’intéresser aujourd’hui aux représentants d’intérêts au sens large permettant de dessiner un panorama global de tous ceux qui concourent à influencer les décisions publiques.
Troisième phénomène : L’intérêt porté au sujet
On est très dépendant, en science politique, de l’intérêt que portent les pouvoirs publics à certains sujets et cela est devenu encore plus vrai avec les modes de financements de nos recherches. En tant que chercheur, on est sous contrôle à la fois des pouvoirs publics et de nos pairs. Tout ce qui ne rentre pas dans l’air du temps est assez difficile à faire financer et donc on ne prend pas le temps de l’étudier tout simplement.
À titre d’exemple, j’ai voulu faire financer des recherches, dans les années 90 sur le CES (aujourd’hui le CESE). On m’a répondu que cela n’avait pas le moindre intérêt. J’ai néanmoins tenu bon et ai continué mes travaux, mais « au-dessus », personne ne s’y intéressait. Autre anecdote, très symptomatique de la période : j’avais envoyé une étudiante à l’Assemblée nationale pour faire un préprojet de thèse sur les groupes d’études au Parlement. Tout le monde dans le microcosme sait ce que sont les groupes d’études. L’administrateur qui les gérait a répondu à cette doctorante que cela n’existait pas. Fin de la recherche.
Cela illustre parfaitement le contexte, il faut que quelqu’un y porte un intérêt sinon c’est secondaire, technique et ennuyeux. Mais d’une certaine manière c’est toujours vrai, pour que cela soit financé, il est nécessaire qu’il y ait un engouement : pour les maisons d’édition, le côté technique et ennuyeux de l’approche de la vie politique par le lobbying, c’est une tarte à la crème. Même pour cet ouvrage, on a reçu des refus parce qu’ils considéraient que c’était une facette qui n’a aucun intérêt… Donc voilà, je pense qu’on commence à avoir un ciel qui se dégage, quelques trouées dans la nuée, mais on vient de loin.
Selon vous, quelles évolutions récentes ont permis un regain d’intérêt pour ces métiers (ex : premier quinquennat d’Emmanuel Macron, tensions sur le commerce international nécessitant de prendre plus en compte encore les acteurs économiques…) ?
Le Parlement veut exister
Je pense que le regain est arrivé avant le premier quinquennat du Président Macron. Dans mon précédent ouvrage, je m’étais d’ailleurs attaché à montrer un éclaircissement dès le milieu des années 2000 notamment via le Parlement.
Les parlementaires en ont sans doute eu un peu assez d’être sous la dépendance de l’exécutif. S’intéresser aux groupes d’intérêt, c’était une façon de démontrer l’importance du Parlement et de sa connexion avec les acteurs économiques, sociaux, avec « le terrain ».
Cette rhétorique commence de façon timide en 2006, puis en 2009 avec le premier règlement de l’Assemblée pour devenir assez forte. De manière assez basique, montrer qu’on est assailli par les représentants d’intérêts, c’est démontrer sa puissance.
On est aujourd’hui toujours dans ce jeu assez classique entre parlementaires et exécutif pour la Vème (on le voit avec la loi Sapin 2 où tout doit venir des parlementaires).
L’affaire Cahuzac
Mais la grande éclaircie, c’est l’affaire Cahuzac. L’exécutif n’a pas eu d’autre choix que d’entrer dans le jeu pour en discuter car d’une certaine manière la maison brulait. à cela s’ajoute l’importance de la force morale du rapport Nadal et des déontologues de l’Assemblée. Tout ça a obligé l’exécutif à céder et à lancer la loi Sapin 2.
« L’ère Macron » un avant / après ?
Pour en revenir à la spécificité du premier quinquennat Macron et à l’impact de l’ouverture « à la société civile » il pose une difficulté d’analyse car il est synchrone avec l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2. Les deux registres existants au Parlement (AN et Sénat) avant Sapin 2 ne valent rien comparé à AGORA. Avant il n’y avait pas de travail des institutions pour obliger à s’enregistrer, on ne peut donc pas les comparer.
En revanche, je vois un certain paradoxe qui émerge du premier quinquennat : D’un côté, on incite énormément les acteurs économiques à agir et il y a un prima qui est donné à tout ce qui représente les intérêts les plus aux goûts du jour. Mais en même temps, il y a un discours assez critique sur l’inintérêt que représentent les corps intermédiaires qu’on accuse d’être dépassé dans le nouveau monde.
On a finalement mis à jour un système de représentation des intérêts qui est super libéral. Il est plus libéral que l’Union européenne.
On a le système de représentation des intérêts qui est le plus pauvre en représentants de la société civile. Ce n’est pas pour dire que la loi ne doit pas prendre en compte les intérêts économiques. Mais on est aujourd’hui à plus de 70%… Il y a, à mon sens, un vrai travail de réflexion sur, non pas la société que l’on veut, mais sur le monde politique que l’on veut. Il y a des voix qui ne sont absolument pas entendues et prises en compte par les décideurs.
Notes de la rédaction :
- Pour lire la partie 2 de notre entretien : Entretien avec Guillaume Courty, Partie 2 : Le monde des consultants en Affaires publiques vu par la recherche académique
- Pour vous procurer l’ouvrage, voici le lien vers l’éditeur : https://classiques-garnier.com/les-groupes-d-interet-en-france.html